|
agonia romana v3 |
Agonia - Ateliere Artistice | Reguli | Mission | Contact | Înscrie-te | ||||
|
|
| |||||
| Articol Comunităţi Concurs Eseu Multimedia Personale Poezie Presa Proză Citate Scenariu Special Tehnica Literara | ||||||
 |
|
|||||

agonia 
■ Urban
Romanian Spell-Checker Contact |
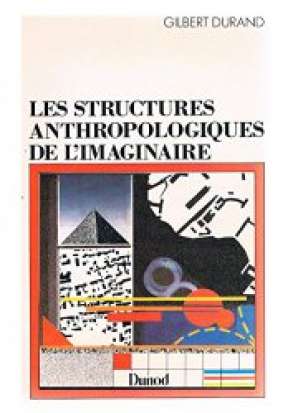
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2016-04-01 | [Acest text ar trebui citit în francais] |
1. La genèse réciproque
Dans sa démarche, Gilbert Durand a valorisé la dynamique des images plus que leur forme. Cette position implique que ni les pulsions subjectives ni les intimations objectives ne sont ontologiquement premières. Et c’est là l’une de ses thèses. Cette position a permis à l’anthropologue grenoblois d’analyser les symboles et archétypes cycliques en partant du milieu astro-biologique, en passant ensuite à l’environnement technologique et en débouchant enfin sur le schème psycho-physiologique, alors que pour le déchiffrage des autres symboles et archétypes il a pris comme point de départ le schèmatisme psycho-physiologique. Il a démontré de cette façon que l’étude des images se satisfait indifféremment d’une démarche culturaliste ou d’une démarche psychologiste. Dans un autre ordre d’idées, cette position lui a permis d’avancer l’idée selon laquelle les images transcendent aussi bien les incidentes caractérielles ou sexuelles que les incidentes sociales. Par la même occasion, il a montré en quoi le mécanisme freudien de la censure est réducteur: « L’imagination selon les psychanalistes est le résultat d’un conflit entre les pulsions et leur refoulement social, alors qu’au contraire elle apparaît la plupart du temps comme résultant d’un accord entre les désirs et les objets de l’ambiance sociale et naturelle. » (Durand, 1963 : 30). Sur ce dernier point il faut quand même dire que « l’accord entre les désirs et les objets de l’ambiance sociale et naturelle » n’a pas plus de chances de se manifester que le désaccord, étant donné que ni l’un, ni l’autre ne dépendent du sujet. Le sujet vit, certes, l’accord ou le désaccord, y participe, mais indépendemment de sa volonté. D’ailleurs, Gilbert Durand écrit lui-même ceci: « subir une action est certes différent de la faire, mais c’est encore en un sens y participer ». (Durand, 1963 : 220). Justement, ce qui fait la différence entre vivre l’accord ou le désaccord avec les objets de l’ambiance sociale et naturelle et exercer une action sur ces objets c’est la différence entre subir une action et la faire. La liberté de choisir n’est présente que dans le deuxième cas. Le sujet a alors la liberté de rechercher les objets qui ont été en accord avec ses désirs, comme il est libre d’éviter les objets qui ont contrarié ses attentes, mais il ne peut rien contre l’action que ces objets ont exercé ou exerceront sur lui. Cette action il la subit. Gilbert Durand dit que le schème du mouvement organise les symboles et il le démontre. Mais il manque un maillon à sa démonstration. Il ne dit pas ce qui fait que ce schème soit ascendant plutôt que descendant, ou inversement. Plus précisément, il ne dit pas ce qui oriente le mouvement et motive par là les symboles qu’il organise. D’autant plus que ce qui les motive réduit aussi leur polyvalence. En fait, ce qui active un schème du mouvement au détriment d’un autre et enclenche éventuellement le changement de Régime c’est l’accord ou le désaccord entre les besoins d’un individu et les objets de son ambiance naturelle et sociale. Et c’est pareil pour le changement de Régime de toute une communauté. La logique réversible du trajet anthropologique demande à son tour une précision. Dans la naissance des images, il y a en effet « genèse réciproque » entre l’environnement matériel et le « geste pulsionnel ». Et Gilbert Durand prend soin de préciser non seulement comment naissent les images, mais aussi où elles naissent : « au niveau de l’imaginaire » . L’image occupe donc une place dans la psyché de l’anthropos. Or elle ne peut occuper cette place que par rapport à d’autres représentations, la psyché étant justement ce lien entre les représentations. La place qu’une image occupe indique l’ordre de son arrivée dans la psyché. Et cet ordre, en raison des liens qu’elle noue avec les représentations précédentes, est irréversible. Quant aux liens, elles se font à base d’analogies et créent les constantes que partagent les individus d’une même communauté, dans notre cas, la communauté humaine. L’ordre de succession des représentations créent les différences, qui se manifestent d’une communauté humaine à l’autre, d’un individu à l’autre, et sont irréductibles. En raison des constantes, la probabilité qu’un individu ou une communauté d’individus agisse d’une manière plutôt que d’une autre est forte. A cause des différences cette probabilité ne peut jamais devenir certitude. Mais la cognoscibilité, favorisée par les constantes et occultée par les différences, ne résume pas toute la problématique du trajet durandien. Il y a encore son fonctionnement, sa réversibilité, qui pose problème. Et là le rôle des différences est premier, étant donné qu’elles seules peuvent motiver une action de sens contraire, peuvent remettre en marche le « trajet ». Chez Gilbert Durand il y a un certain flottement dans la définition du concept de trajet anthropologique. Ainsi, si les deux formulations suivantes se rapprochent, la troisième comporte un élément nouveau, difficile à intégrer: « Il faut nous placer délibérément dans ce que nous appellerons le trajet anthropologique, c'est-à-dire l'incessant échange qui existe au niveau de l'imaginaire entre les pulsions subjectives et assimilatrices et les intimations objectives émanant du milieu cosmique et social. » (Durand, 1963 : 31) « Nous postulerons une fois pour toutes qu'il y a genèse réciproque qui oscille du geste pulsionnel à l'environnement matériel et social, et vice versa. » (Durand, 1963 : 31) « Finalement l’imaginaire n’est rien d’autre que ce trajet dans lequel la représentation de l’objet se laisse assimiler et modeler par les impératifs pulsionnels du sujet, et dans lequel réciproquement, comme l’a magistralement montré Piaget, les représentations subjectives s’expliquent par les accommodations antérieures du sujet au milieu objectif. » (Durand, 1963: 31-32) Je commencerai par énumérer les éléments communs aux trois formulations. Tout d’abord, « les pulsions subjectives et assimilatrices » qui deviennent par la suite « geste pulsionnel » et, respectivement, « impératifs pulsionnels du sujet ». Ensuite, « les intimations objectives émanant du milieu cosmique et social » qui prennent la forme de « l’environnement matériel et social » et, respectivement, de « l’objet » dont la représentation se laisse assimiler et modeler. Enfin, l’idée d’échange incessant qui est rendue une fois par l’expression « genèse réciproque », une autre fois par le mot « réciproquement ». Quant à l’élément nouveau, il est représenté « par les accommodations antérieures du sujet au milieu objectif », qui, dit Gilbert Durand à la suite de Jean Piaget, sont de nature à expliquer le caractère subjectif des représentations. Inutile de dire qu’il ne peut y avoir de « genèse réciproque » entre trois éléments, qu’un de ces élément est donc de trop. Et quelque curieux que cela puisse paraître ce n’est pas le troisième. « Les accommodations antérieures du sujet au milieu objectif » font référence à l’ expérience antérieure du sujet et cette expérience, différente d’un sujet à l’autre, modèle en effet l’objet représenté. En parlant de l’ordre de succession des représentations qui est différent d’un individu à l’autre, j’ai pratiquement exprimé la même idée, tout en mettant en avant l’idée de succession et d’ordre de succession. Ensuite, dans la troisième formulation, on a deux sources de subjectivité, alors qu’une seule suffit. En fait, « les impératifs pulsionnels » accompagnent l’expérience antérieure du sujet et vont colorer affectivement sa nouvelle expérience. Ces gestes bio-psychologiques que sont les impératifs pulsionnels sont toujours ancrés dans l’expérience. Sous la forme de l’accord ou du désaccord du sujet avec l’objet nouvellement représenté, ils vont orienter les choix ultérieurs du sujet, ses actes. Autrement dit, ils jouent un rôle important, mais non pas pour le sujet en tant que patient mais pour le sujet en tant qu’agent. Et après tout, c’est le sujet dans son hypostase d’agent qui conduit au changement de Régime ou à son maintien. 2. La primauté de l’image Une autre thèse concerne la primauté de l’image sur le concept, du sens figuré sur le sens propre. Pour tout dire, Gilbert Durand déplace l’imagination de la périphérie vers le centre et fait subir un mouvement contraire à la raison qui « apparaît, à la limite, comme une activité régionale, restreinte de l’esprit, dont l’imagination serait la forme amplifiée, généralisée. » (Wunenburger, 2015 : 20). Mais l’idée de genèse réciproque exclut toute idée de primauté. Pour le prouver, j’ai construit un exemple à partir d’un événement qui s’est déroulé du 9 mars au 3 juillet 2015. Il s’agit du tour du monde en avion solaire, un avion conçu pour voler jour et nuit sans avoir besoin de carburant et surtout sans polluer l'environnement. En supposant que 2 milliards d’individus soient au courant du tour du monde en avion solaire, on aura 2 milliards de représentations différentes de l’événement. Et comme il n’y a pas de représentation neutre, des valeurs différentes accompagneront ces représentations. Cela donnera finalement 2 milliards de façons différentes de se rapporter au même événement. Selon Gilbert Durand ces différences s’expliquent par les accommodations antérieures du sujet au milieu objectif. Ou ce qui revient au même, par le parcours différent de chaque individu. Plus exactement, la représentatation de l’évenement se laisse assimiler et modeler par les représentations antérieures de chacun des 2 milliards d’individus. Les représentations antérieures, à leur tour, se trouvent modifiées par l’assimilation de la nouvelle représentation. Il y a ainsi un double mouvement, de l’objet vers le sujet et inversement ou ce que Gilbert Durand appelle genèse réciproque. Ce qui est important c’est que ce double mouvement s’inscrit chaque fois dans les limites d’une représentation antérieure. Disons par exemple qu’une partie des individus qui sont au courant de l’événement n’ont pas la notion de vol en avion solaire. Dans ce cas la nouvelle représentation se formera dans les limites d’une notion qu’ils ont déjà, celle de vol en avion. Si, exceptionnellement, il y a des individus qui n’ont pas la notion de vol en avion, la nouvelle représentation se formera dans les limites de la notion de vol en général. Et si par absurde, il y a des individus qui n’ont pas la notion de vol non plus, la nouvelle représentation se formera dans les limites de la notion de mouvement, qui est encore plus générale. Dans tous les cas, il y a une notion antérieure qui accueille la nouvelle représentation. Celle-ci, de son côté, fait que la notion antérieure s’affine, se différencie. Le mouvement prendra ainsi la forme du vol, le vol deviendra vol en avion. Le vol en avion deviendra à son tour vol en avion solaire. Et s’il y a des individus qui ont déjà la notion de vol en avion solaire, c’est cette notion qui va s’affiner au fur et à mesure du déroulement de l’événement. Une première conclusion : on peut ne pas avoir le concept de vol en avion solaire, mais on ne peut se représenter le vol en avion solaire en dehors de tout concept. Et cette représentation, même si le concept n’est pas le même pour tous, n’est pas moins objective, étant donné que le vol en avion solaire est tout cela : mouvement, vol, vol en avion. Seul le degré de compréhension est différent. La représentation du vol en avion solaire, d’autre part, est connotée positivement ou négativement, elle n’est jamais tout à fait neutre. Selon les individus, elle est teintée d’espoir, de crainte, de doute, de méfiance, de terreur, etc : l’espoir de réussir, la crainte d’échouer, la méfiance face au mobile du vol, le doute quant à l’endurance des pilotes, la terreur du vide, etc. Cette représentation est donc non seulement l’expression de l’objet, le vol en avion solaire, mais aussi de l’attitude du sujet vis-à vis de cet objet. Elle est subjective. La difficulté est pourtant ailleurs. Comment une image subjective, chargée affectivement, peut-elle transcender les différences caractérielles, sexuelles ou sociales, comment peut-elle accéder au statut de symbole et d’archétype ? Gilbert Durand y répond en disant que le schème du mouvement, qui sous-tend les dominantes posturale, digestive, cyclique, organise les images. Ce schème, commun à tous les humains, fait que les images soient ontologiquement premières et qu’elles subsument les concepts. En fait, chaque schème, qu’il soit ascendant, descendant ou cyclique, valorise certains attributs de l’objet au détriment des autres, de sorte que les constellations d’images sont finalement des constellations de valeurs. Mais les choses auxquelles les valeurs d’une constellation se rapportent débordent la constellation. Gilbert Durand a magistralement découvert des constantes de la subjectivité, des constantes liées à la nature commune des humains. Mais il faut dire que le mécanisme qui mène à la formation des concepts, contribue à la formation des symboles et archétypes aussi. Prenons l’état qui accompagne la représentation du vol en avion solaire. Il est déterminé par le vol, mais aussi et par l’état que chacun des 2 milliards individus ont eu lors d’expériences similaires. Des expériences positives appelleront ainsi un sentiment de confiance et d’espoir. Des expériences négatives viendront, par contre, gâcher le plaisir que les individus pourraient avoir à suivre le déroulement du vol en avion solaire. Si dans une expérience antérieure, positive ou négative, un de ces individus a été impliqué directement, des émotions fortes feront surface. Le nouvel événement, de son côté, renforcera ou atténuera ces émotions. Et son influence sera d’autant plus importante que l’enjeu de l’événement pour l’individu est important. En général, un événement, quel qu’il soit, peut se dérouler bien ou mal ou plus ou moins bien et son enjeu peut être minime ou colossal ou entre les deux. Pour un individu donné, la valeur d’un événement découle, d’une part, des paramètres de l’événement, d’autre part, des événements similaires que cet individu a vécus. Formée dans les limites d’une valeur antérieure et déterminée dans sa formation par un événement nouveau, la nouvelle valeur est une constante et une variable aussi. Quoiqu’il en soit, elle est l’expression de la relation de l’individu avec l’événement et comme telle, elle ne peut épuiser l’événement dont l’expression est le concept. Le concept fait de la représentation de l’événement une information qui guide l’individu dans le monde hors de lui. Mais, étant neutre, le concept ne met pas l’individu en état d’agir. La valeur, de son côté, transforme la représentation de l’événement en image. Et cette image, chargée affectivement, fait l’individu agir et agir d’une façon plutôt que d’une autre. La dimension ontologique de l’image est indéniable et l’anthropologue grenoblois a eu raison de se battre pour la réhabiliter, mais non pas au détriment du concept. Il y a de la place pour les deux. Personne ne conteste le fait que l’homme peut agir bien mais il peut agir mal aussi. Il agit bien chaque fois qu’il agit en accord avec la réalité autour de lui et mal quand il agit en désaccord avec cette réalité. Mais dans un cas comme dans l’autre, consciemment ou inconsciemment, il agit en accord avec lui-même. L’expression de l’accord avec lui-même est l’image qu’il se fait de la réalité, qui est toujours subjective. L’expression de l’accord ou du désaccord avec la réalité est le concept, qui peut être vrai ou faux. 3. Le sémantisme de l’image Une dernière thèse est celle du sémantisme de l’image. Selon cette thèse, l’image est motivée, à la différence du signe linguistique qui est arbitraire. Dans l’image il y aurait donc homogénéité du sens et de la forme. Cette thèse mérite, certes, d’amples développements. Je me contenterai ici de lui opposer une autre thèse, celle selon laquelle l’image n’est pas plus motivée que le signe linguistique et le signe n’est pas plus arbitraire que l’image, la polyvalence de l’un comme l’autre se laissant réduire par le contexte. Il faut encore préciser le sens que je donne au mot contexte. Pour ce faire, je me rapporterai à une situation de communication à trois interlocuteurs et je dirai, en accord avec les considérations antérieures sur le trajet anthropologique, qu’à cette situation correspondent trois contextes différents. C’est que le sens de ce qui est dit dépend aussi du parcours de chaque interlocuteur, de ses « accommodations antérieures » au milieu linguistique et social. Qu’en est-il de l’image ? Une image, tout en étant différente d’un sujet à l’autre, comporte des éléments qui sont communs à tous les sujets et qui font que l’image puisse s’ériger en symbole. Prenons le vol en avion. Pour tous les 2 milliards d’individus, il est un superlatif du déplacement et une promesse de réalisation de leurs rêves les plus audacieux. En même temps, il est le déplacement à haut risque par excellence, la chute étant le contrepoint de l’ascension. L’avion, de son côté, symbolise, dans sa qualité d’embarcation, les péripéties du voyage ; il a un caractère dramatique. En tant que vaisseau fermé, il participe par contre au grand thème de « la berceuse maternelle », il est le symbole de l’intimité rassurante, et les compagnies aériennes promeuvent cette image. Quant au vol en avion solaire, il est un vol expérimental qui met de son côté toutes les chances et assume tous les risques. Il incarne cette volonté de puissance, de transcendance caractéristique du Régime Diurne. Par son intention, celle de promouvoir les énergies renouvelables et de préserver les ressources de la Terre, ce vol se laisse accaparer par le Régime Nocturne. Le tour du monde en avion solaire est finalement emblématique de cette tendance qui va en s’accentuant depuis la fin du XXe siècle et qui consiste à rechercher « l’antidote du temps » dans la rassurante et chaude intimité de la substance, tellurique ou marine, et dans les constantes rythmiques qui scandent les phénomènes de la Terre. Mais cette tendance se réalise au moyen d’innovations techniques et en privilégiant les héros et leurs prouesses au détriment de l’accord avec la nature. Tous les 2 milliards d’individus qui suivent le tour du monde en avion solaire partagent ces ces valeurs, mais toutes ces valeurs ne sont pas actualisées pour tous de la même façon. Et cela doit être mis en rapport avec le parcours de chacun. Ou pour citer Gilbert Durand : « Le monde de l’objectivité est polyvalent pour la projection imaginaire, seul le trajet psychologique est simplificateur. » (Durand, 1963 : 261) En transcendant ces différences, on dira que ce début de XXIe siècle est à tendance « nocturne » et à prépondérance « diurne », qu’il fonctionne sur les deux Régimes. Bibliographie Gilbert, Durand, 1963, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Presses universitaires de Paris. Gilbert, Durand, 1994, L’imaginaire. Essai sur les sciences et la philosophie de l’image, Paris, Hatier. Gilbert, Durand, 1996, Introduction à la mythodologie. Mythes et sociétés, Paris, Albin Michel. Wunenburger, Jean-Jacques, 2015, « Imaginaire et rationalité chez Gilbert Durand. D’une révolution copernicienne à une nouvelle sagesse anthropologique », Variations sur l’imaginaire – L’épistémologie ouverte de Gilbert Durand Orientations et innovations – Yves Durand, Jean-Pierre Sironneau, E.M.E., pp. 4-31.
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Casa Literaturii, poeziei şi culturii. Scrie şi savurează articole, eseuri, proză, poezie clasică şi concursuri. | |||||||||
 |
|
